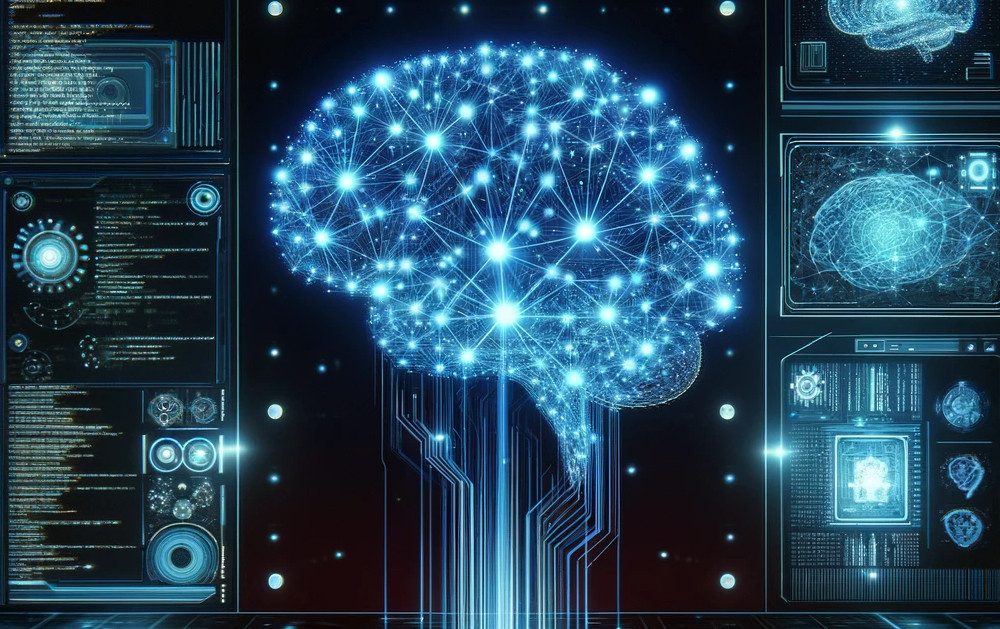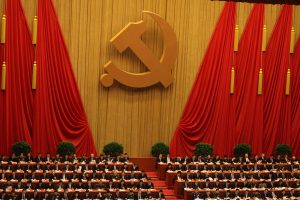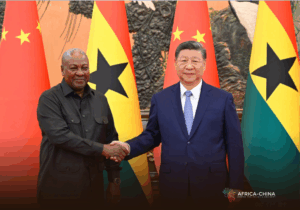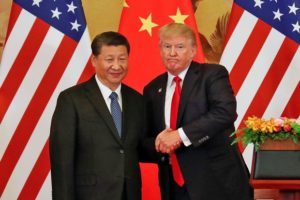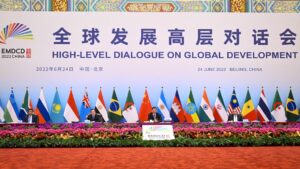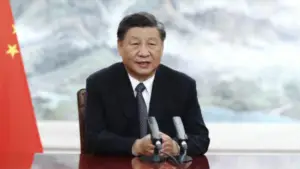Ce que la Rome antique peut apprendre à la Chine sur l’effondrement démographique
De Project Syndicate, par Yi Fuxian – Le 28 juillet, la Chine a annoncé une nouvelle subvention mensuelle pour la garde d’enfants de 300 CNY (42 $) pour chaque enfant de moins de trois ans. Visant à stimuler le taux de fécondité du pays, cette politique marque un tournant radical : il y a quelques années encore, les familles étaient condamnées à des amendes représentant trois à dix fois le revenu annuel par habitant pour les naissances non autorisées.
Les défis démographiques actuels de la Chine et les réponses politiques qu’elle y apporte présentent des similitudes frappantes avec ceux de la Rome antique, où, pour maintenir la population, chaque femme ayant atteint la ménopause devait avoir entre cinq et sept enfants . Pourtant, malgré ce déficit, les Romains pratiquaient activement l’eugénisme. Comme le déclarait Sénèque, conseiller de l’empereur Néron : « Même les enfants, s’ils naissent faibles ou difformes, nous les noyons. »
Les filles étaient exposées à un risque significativement plus élevé d’infanticide. Seulement 1 % des 600 familles recensées dans les inscriptions delphiques du IIe siècle élevaient deux filles. Cela a entraîné de graves déséquilibres dans les rapports de masculinité : 131 hommes pour 100 femmes à Rome, et jusqu’à 140 hommes pour 100 femmes en Italie et en Afrique du Nord. La pénurie de femmes qui en a résulté a alimenté le déclin démographique. Les mentalités sociales ont aggravé le problème : de nombreux hommes étaient réticents à se marier, malgré les supplications de personnalités comme l’homme d’État romain Metellus Macedonicus, qui insistait sur le fait qu’avoir des enfants était un devoir civique.
La Chine, elle aussi, s’est lancée dans une expérience de contrôle démographique, appliquant la politique de l’enfant unique (sous le slogan teinté d’eugénisme « des naissances moins nombreuses, mais de meilleure qualité ») de 1980 à 2015. Les données officielles montrent que 369 millions d’avortements ont été pratiqués entre 1980 et 2020, dont certains forcés. Rien qu’en 2020, 43 % des grossesses se sont terminées par un avortement.
À l’instar de la Rome antique, la Chine ciblait de manière disproportionnée les fœtus féminins. Le recensement de 2010 enregistrait 119 garçons pour 100 filles de 0 à 9 ans à l’échelle nationale. Dans des endroits comme le comté de Jishui, dans la province du Jiangxi, ce ratio atteignait 163 garçons pour 100 filles. Cette disparité entre les sexes a eu des conséquences démographiques à long terme : les premiers mariages ont diminué de 61 % entre 2013 et 2024. Et cette tendance devrait se poursuivre , car le nombre de femmes âgées de 20 à 34 ans – la tranche d’âge responsable de 85 % des naissances en Chine – devrait diminuer de moitié d’ici 2050.
Pour lutter contre la baisse des naissances, Auguste, premier empereur de Rome, introduisit des réformes natalistes. Parmi celles-ci, la Lex Julia en 18 av. J.-C. et la Lex Papia Poppaea en 9 apr. J.-C., toutes deux visaient à encourager le mariage et la procréation en offrant des récompenses aux parents et en pénalisant les citoyens célibataires ou sans enfants, notamment les hommes de plus de 25 ans et les femmes de plus de 20 ans. Ironiquement, les deux consuls qui rédigèrent la Lex Papia Poppaea étaient eux-mêmes célibataires.
L’élite romaine, dépendant du travail des esclaves plutôt que du soutien familial, était peu encline à élever des enfants. Même Auguste, se souvenant de sa fille unique et biologique, Julia, tombée en disgrâce, aurait soupiré et s’exclamé : « Si seulement je ne m’étais jamais marié et si je mourrais sans descendance ! »
À l’inverse, la Chine impériale, fidèle aux valeurs confucéennes, favorisait un système de soutien familial solide, récompensant l’éducation des enfants et punissant les comportements infidèles aussi sévèrement que la trahison. Dans la Chine moderne, la sécurité sociale gérée par l’État a progressivement remplacé les fonctions économiques traditionnelles de la famille, réduisant ainsi l’incitation à la procréation. Comme l’a exprimé un jeune homme de Shanghai : « Nous sommes la dernière génération. »
L’économie esclavagiste de Rome a atteint des niveaux d’urbanisation de 25 à 30%, comparables à ceux de la Chine dans les années 1990, lorsque les taux de fécondité ont rapidement diminué . Les découvertes archéologiques montrent que les densités de population à Pompéi et à Ostie ont atteint respectivement 17 000 et 32 000 personnes par kilomètre carré, dépassant de loin celles de villes modernes comme Chicago et Londres , qui comptent en moyenne 4 000 à 5 500 personnes par kilomètre carré.
Cette surpopulation urbaine a mis à rude épreuve les infrastructures de la Rome antique et a fait grimper le prix du logement, provoquant un profond bouleversement des valeurs sociales et des modes de vie. Pour les classes supérieures et moyennes, élever des enfants était devenu un fardeau trop lourd. « Les enfants étaient désormais un luxe que seuls les pauvres pouvaient s’offrir », observait l’historien américain Will Durant.
Alors que plus des deux tiers de la population chinoise vit en zone urbaine, la partie construite des villes ne représente que 0,65% du territoire national, en raison de restrictions strictes à l’expansion urbaine. Il en résulte des densités de population urbaine exceptionnellement élevées, comparables à celles de la Rome antique et supérieures à celles du Japon. La densité de population tend à freiner la fécondité ; il n’est donc pas surprenant que le taux de fécondité de la Chine soit tombé en dessous de celui du Japon.
En l’an 100, la faible fécondité s’était propagée au-delà de l’élite romaine, incitant l’empereur Trajan à lancer le programme Alimenta , qui offrait des subventions alimentaires, une aide financière et l’éducation des enfants. Mais même ces incitations ne réussirent pas à inverser la tendance. L’historien Tacite nota plus tard que « les mariages et l’éducation des enfants ne devinrent pas plus fréquents, tant l’attrait d’un État sans enfants était puissant ».
Après des décennies de politique de l’enfant unique, la Chine est devenue une sorte d’« État sans enfant ». En 2023, le taux de fécondité national était tombé à 1,0 naissance par femme, et près de la moitié des districts de Shanghai l’avaient atteint à 0,4.
Confronté à des difficultés financières, à des invasions étrangères et à des difficultés administratives croissantes, l’Empire romain se scinda en deux en 395. L’Empire d’Occident, en proie à une grave crise démographique, s’appuya fortement sur les immigrants barbares pour soutenir son économie et son armée. Mais son incapacité à intégrer ces nouveaux venus conduisit finalement à son effondrement en 476, marquant le début du Moyen Âge millénaire en Europe. L’Empire byzantin oriental, soutenu par des taux de fécondité et une richesse accrus, survécut encore mille ans.
L’Empire romain a fait davantage pour lutter contre son déclin démographique que les autorités chinoises ne semblent prêtes à le faire aujourd’hui, mais il n’a pas réussi à se sauver. La Chine est également confrontée à des défis auxquels Rome n’a jamais eu à faire face, comme la contraception généralisée, l’augmentation de l’âge de la procréation et l’affectation des ressources aux retraites et aux soins aux personnes âgées au détriment du soutien aux familles et à l’éducation des enfants.
Alors que les pays du monde entier sont confrontés à des crises démographiques, il semble que tous les chemins mènent à Rome. Le taux de fécondité aux États-Unis, par exemple, est passé de 2,1 en 2007 à moins de 1,6 en 2024, contre 1,38 dans l’Union européenne et 1,26 au Canada.
La situation de la Chine est cependant particulièrement périlleuse. À moins d’être inversée, un déclin démographique d’une telle ampleur pourrait rappeler l’effondrement de l’Empire romain.
 Yi Fuxian, scientifique senior à l’Université du Wisconsin-Madison, a été le fer de lance du mouvement contre la politique de l’enfant unique en Chine et est l’auteur de Big Country with an Empty Nest (China Development Press, 2013), qui est passé d’une interdiction en Chine à la première place du classement des 100 meilleurs livres de 2013 en Chine établi par China Publishing Today .
Yi Fuxian, scientifique senior à l’Université du Wisconsin-Madison, a été le fer de lance du mouvement contre la politique de l’enfant unique en Chine et est l’auteur de Big Country with an Empty Nest (China Development Press, 2013), qui est passé d’une interdiction en Chine à la première place du classement des 100 meilleurs livres de 2013 en Chine établi par China Publishing Today .
Droits d’auteur : Projet Syndicate, 2025.
www.project-syndicate.org