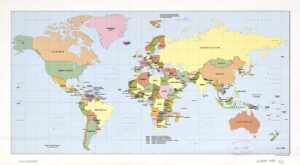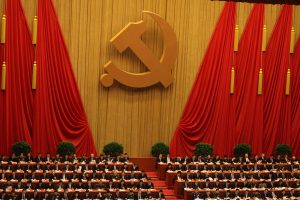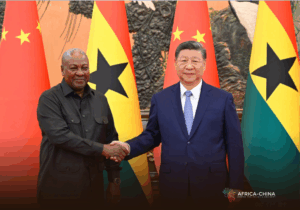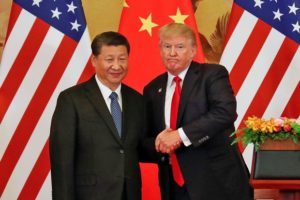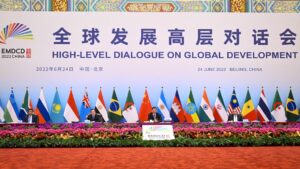La nouvelle exportation imbattable de la Chine
De Project Syndicate, par Jeffrey Wu – « On ne peut pas laisser les Chinois exporter pour retrouver la prospérité », affirme le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent, qui affirme que l’économie chinoise est « a plus déséquilibrée de l’histoire ». De telles remarques reflètent la crainte croissante à Washington que la surcapacité, les subventions et le dumping de la Chine faussent le commerce mondial.
La préoccupation la plus pressante, cependant, n’est pas de savoir ce que la Chine exporte, mais comment. Les structures de coûts mondiales sont bel et bien remodelées, mais par une force plus discrète et plus complexe : l’amélioration constante de la productivité. La Chine ne se contente pas de déplacer davantage de marchandises ; elle exporte un nouveau modèle de production, fondé sur l’automatisation, l’IA et l’optimisation industrielle pilotée par l’État. Cette évolution est disruptive, déflationniste et encore largement méconnue.
L’ascension de la Chine comme usine mondiale à la fin du XXe siècle était portée par la main-d’œuvre et les économies d’échelle. Mais aujourd’hui, la Chine vise une nouvelle forme de domination grâce à des infrastructures intelligentes. Ne se limitant plus aux applications ou aux chatbots, l’IA est intégrée à l’ensemble de l’économie physique, pilotant tout, des bras robotisés et des flottes d’entrepôts aux lignes de production autonomes. Par exemple, l’usine « light-out » de Xiaomi à Pékin peut assembler dix millions de smartphones par an avec une intervention humaine minimale. L’IA pilote une symphonie de capteurs, de machines et d’analyses qui forment une boucle industrielle étroitement tissée, générant des gains d’efficacité que les fabricants traditionnels ne peuvent atteindre que progressivement.
Cet écosystème technologique ne se limite pas à une seule usine. Le modèle de langage open source de 671 milliards de paramètres de DeepSeek est déjà déployé non seulement pour le codage, mais aussi pour optimiser la logistique et la fabrication. JD.com réorganise ses réseaux d’approvisionnement grâce à l’automatisation. Unitree exporte des robots d’entrepôt bipèdes. Et Foxconn (principal partenaire industriel d’Apple) développe des micro-usines modulaires pilotées par l’IA afin de réduire sa dépendance aux chaînes de production statiques.
Ces exemples ne représentent peut-être pas une « innovation de prestige », mais ils témoignent d’une vaste culture d’optimisation industrielle. Sous la bannière de « nouvelles forces productives de qualité », le gouvernement chinois déploie des zones pilotes d’IA et subventionne la modernisation des usines ; et des villes comme Hefei et Chengdu offrent des subventions locales dont l’ampleur rivalise avec celle des initiatives nationales menées ailleurs.
Cette stratégie fait écho à celle menée par l’industrie japonaise dans les années 1980, lorsque l’automatisation, la production allégée et la consolidation industrielle ont permis aux entreprises de surpasser leurs concurrents mondiaux. Mais l’approche chinoise va plus loin, alliant l’IA aux économies d’échelle, aux boucles de rétroaction et à une dynamique culturelle unique appelée involution (neijuan) : une course perpétuelle à l’optimisation et à la compétitivité, souvent au détriment des marges bénéficiaires. BYD, l’un des constructeurs automobiles les plus intégrés verticalement au monde, a récemment baissé les prix de dizaines de modèles, déclenchant une chute de 20 milliards de dollars de son cours de bourse .
Dans des secteurs allant du commerce électronique aux véhicules électriques, cette pratique a entraîné une compression des coûts si implacable que l’État a parfois jugé bon d’intervenir. En avril 2025, le Quotidien du Peuple avertissait qu’une involution extrême fragilisait la stabilité du marché, évoquant une guerre des prix destructrice dans la livraison de repas entre JD.com, Meituan et Ele.me. Le problème est encore plus aigu dans le secteur des véhicules électriques. Alors que plus de 100 marques chinoises de véhicules électriques sont actuellement en concurrence, plus de 400 ont fait faillite depuis 2018.
La compétition mondiale est impitoyable. Ceux qui survivent en ressortent plus agiles, plus adaptables et mieux positionnés que leurs homologues traditionnels. C’est ainsi que les constructeurs chinois de véhicules électriques ont réussi à s’imposer en Europe, proposant des modèles à des prix que les entreprises locales peinent à égaler. Vu de loin, le processus paraît chaotique. En pratique, cependant, il s’apparente à une sélection naturelle. La Chine favorise délibérément l’évolution industrielle : l’État favorise un large éventail de concurrents, puis laisse le marché les sélectionner.
Cette approche se propage dans tous les secteurs . Dans le domaine des panneaux solaires, les fabricants chinois représentent désormais plus de 80% de la capacité de production mondiale, ce qui a entraîné une baisse des prix de plus de 70% au cours de la dernière décennie. Une tendance similaire se dessine dans le secteur des batteries pour véhicules électriques, où les entreprises chinoises dominent la courbe du coût par kilowatt. Mais ne vous y trompez pas : cette déflation ne résulte pas d’une offre excédentaire ou d’un dumping. Elle reflète une refonte des structures de coûts, fruit de l’IA, d’une concurrence intense et d’une itération incessante.
L’industrie chinoise a ainsi fait de l’efficacité un atout commercialisable, transformant ainsi la dynamique des prix mondiaux. Une fois cette évolution véritablement enclenchée, les entreprises du monde entier devront ajuster leurs stratégies de prix, leur déploiement de main-d’œuvre et la configuration de leurs chaînes d’approvisionnement.
Mais cette évolution présente de nouveaux défis pour de nombreuses économies. Prenons le rôle des banques centrales, dont la mission est d’assurer la stabilité des prix. Que peuvent-elles faire si l’inflation est contenue non pas par une faible demande, mais par une meilleure efficacité de l’offre provenant de l’étranger ? Dans un tel scénario, la politique monétaire perdra probablement de son élan. La progression des avancées logicielles ne ralentira pas simplement parce que les taux d’intérêt augmentent ou baissent. Au contraire, la politique industrielle devra s’imposer – non pas comme une forme de protectionnisme, mais comme une nécessité adaptative. Le clivage fondamental ne se situera plus entre capitalisme et planification étatique, mais entre systèmes statiques et dynamiques.
La loi américaine sur la réduction de l’inflation et la loi CHIPS and Science, ainsi que le plan industriel du Pacte vert de l’UE, ont certes constitué les premiers efforts occidentaux pour défier l’avance chinoise ; mais ces mesures étaient largement réactives, cloisonnées ou axées sur des nœuds en amont comme les puces. Alors que les États-Unis et leurs alliés déploient des droits de douane, des subventions et des contrôles à l’exportation, la véritable compétition porte sur l’intégration de l’IA dans l’économie réelle : non pas qui construira le chatbot le plus intelligent, mais qui construira l’usine la plus intelligente, et dont le modèle pourra être reproduit durablement à grande échelle.
Bien sûr, le modèle chinois comporte des inconvénients. Les conditions de travail pourraient se dégrader sous l’effet d’une réduction incessante des coûts ; l’offre excédentaire demeure un risque systémique ; les excès réglementaires peuvent faire dérailler les progrès ; et tous les gains d’efficacité ne se traduisent pas par une prospérité partagée. Les consommateurs peuvent en bénéficier, mais ce sont les travailleurs et les petites entreprises qui subiront le poids de l’ajustement.
Mais même si le modèle chinois n’est pas universellement reproductible, il soulève d’importantes questions pour les décideurs politiques du monde entier. Comment les autres pays pourront-ils concurrencer des systèmes qui produisent plus, plus vite et moins cher – non pas par la suppression des salaires, mais par l’ingéniosité ?
Considérer l’approche chinoise comme une simple distorsion revient à passer à côté de l’essentiel. Le gouvernement chinois ne se contente pas de jouer le jeu commercial traditionnel avec plus de rigueur ; il en modifie les règles, et ce non pas par des droits de douane, mais par une transformation industrielle. Si la dernière vague de mondialisation a été axée sur une main-d’œuvre moins chère, la prochaine sera axée sur des systèmes plus intelligents. L’intelligence ne résidera plus uniquement dans le cloud, mais dans les machines, les entrepôts et les chaînes de montage fonctionnant 24 h/24 et 7 j/7.
Aujourd’hui, le principal produit d’exportation de la Chine n’est pas un produit, mais un procédé. Et il redéfinira la nature de la concurrence mondiale.
 Jeffrey Wu est directeur chez MindWorks Capital.
Jeffrey Wu est directeur chez MindWorks Capital.
Droits d’auteur : Project Syndicate, 2025.
www.project-syndicate.org