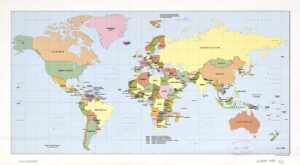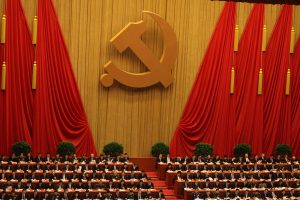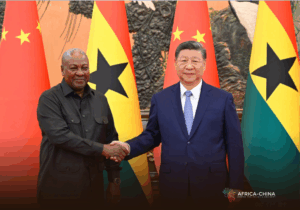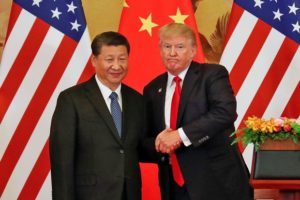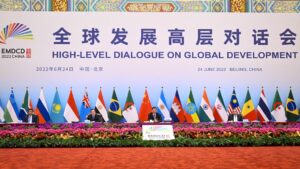Les terres rares sont l’atout de la Chine
De Project Syndicate, par Angela Huyue Zhang – L’utilisation des terres rares comme arme par la Chine est devenue un point de discorde majeur dans les négociations commerciales sino-américaines.
Ces matériaux essentiels, notamment les aimants haute performance qu’ils permettent de fabriquer, sont des composants essentiels des véhicules électriques (VE), des éoliennes, de la robotique industrielle et des systèmes de défense avancés. Face aux contrôles stricts imposés par la Chine sur les exportations de terres rares, les États-Unis ont discrètement abaissé leurs droits de douane, assoupli les contrôles à l’exportation des puces d’intelligence artificielle et même assoupli les restrictions de visa pour les étudiants chinois.
Parallèlement, les États-Unis s’efforcent de trouver des sources d’approvisionnement alternatives. En juillet, le ministère de la Défense a annoncé un plan d’investissement historique de plusieurs milliards de dollars pour soutenir MP Materials, l’entreprise à l’origine du projet phare américain sur les terres rares. Mais que se passerait-il si, malgré des subventions massives et des années d’efforts, les États-Unis ne parvenaient toujours pas à se libérer de leur dépendance aux terres rares chinoises ?
Le Japon offre un exemple édifiant. En 2010, à la suite d’un affrontement maritime au sujet des îles Senkaku, la Chine a brutalement interrompu ses exportations de terres rares vers le Japon. En réaction, le gouvernement japonais a mis en œuvre une série de mesures stratégiques : investir dans Lynas Rare Earths, un producteur australien ; stimuler la recherche et le développement nationaux en matière de recyclage et de substitution ; nouer ses propres partenariats commerciaux avec des fabricants d’aimants chinois ; et constituer des stocks stratégiques pour amortir les futurs chocs d’approvisionnement. Plus de dix ans plus tard, le Japon s’approvisionne toujours à plus de 70% en terres rares auprès de Chine.
La domination de la Chine dans le domaine des terres rares ne s’est pas construite du jour au lendemain et elle ne s’érodera pas facilement. Sa force ne réside pas dans la thésaurisation des matières premières, mais dans sa capacité industrielle à raffiner, transformer et produire à grande échelle. Aujourd’hui, la Chine contrôle entre 85% et 90% de la capacité mondiale de raffinage des terres rares et produit environ 90% des aimants haute performance en terres rares du monde. C’est le seul pays à disposer d’une chaîne d’approvisionnement en terres rares entièrement intégrée verticalement , de l’extraction à la séparation chimique en passant par la fabrication des aimants.
L’avantage manufacturier de la Chine lui a conféré non seulement une avance industrielle, mais aussi un avantage technologique. Entre 1950 et 2018, la Chine a déposé plus de 25 000 brevets liés aux terres rares, soit plus du double du nombre déposé aux États-Unis. Des décennies d’expérience pratique dans la chimie et la métallurgie complexes du traitement des terres rares ont permis d’acquérir une expertise approfondie que les entreprises occidentales peinent à reproduire. De plus, en décembre 2023, le gouvernement chinois a décidé de consolider son avance en imposant des interdictions d’exportation drastiques sur les technologies d’extraction, de séparation et de production d’aimants des terres rares.
La réglementation environnementale laxiste de la Chine a également conféré à ses entreprises un avantage considérable sur leurs concurrents occidentaux. En 2002, la mine de terres rares de Mountain Pass, en Californie, a été contrainte d’ interrompre ses opérations de raffinage après un déversement de déchets toxiques. En revanche, l’environnement réglementaire plus permissif de la Chine a permis à la production de terres rares de croître rapidement, avec moins de retards et des coûts bien inférieurs.
Il est important de noter que les points d’étranglement des terres rares ne sont pas fixes ; ils évoluent avec la technologie. La Chine l’a bien compris, attendant patiemment que la dépendance occidentale aux aimants à terres rares augmente de façon exponentielle avec la transition écologique mondiale, ce qui a créé une demande massive de véhicules électriques et d’éoliennes.
Même si l’Occident parvient à construire une chaîne d’approvisionnement parallèle pour ses besoins actuels en terres rares, les goulots d’étranglement de demain pourraient se situer ailleurs. L’informatique quantique, par exemple, dépend de plus en plus d’isotopes rares comme l’ytterbium-171, ainsi que d’éléments comme l’erbium et l’yttrium. Ces applications émergentes pourraient devenir les prochains points de tension, obligeant les États-Unis et leurs alliés à rattraper leur retard.
Les États-Unis doivent donc affronter une réalité dérangeante : la domination de la Chine dans le secteur des terres rares est susceptible de perdurer dans un avenir proche. Des stratégies défensives, comme la diversification de la chaîne d’approvisionnement, peuvent remédier à certaines vulnérabilités, mais une véritable résilience exige une stratégie offensive qui renforce l’influence américaine.
Les États-Unis détiennent encore de précieux atouts. Tant qu’ils conservent le contrôle des technologies ou des infrastructures indispensables à la Chine – qu’il s’agisse de puces avancées, de modèles d’IA de pointe ou d’accès au système financier basé sur le dollar –, la Chine a tout intérêt à maintenir les flux de terres rares. Pourtant, depuis des années, les États-Unis suivent la voie inverse : découpler et restreindre progressivement les flux de technologies clés vers la Chine.
Depuis la première administration Trump, les États-Unis ont mis sur liste noire les principales entreprises technologiques chinoises et renforcé les contrôles à l’exportation des puces électroniques de pointe. Si ces mesures ont initialement entravé les entreprises chinoises comme Huawei et ZTE, ralentissant le développement de l’IA dans le pays, elles se sont avérées difficiles à appliquer. Perdues dans leurs failles, elles ont créé des opportunités d’arbitrage en matière d’application. Comme l’ a reconnu la secrétaire américaine au Commerce sortante, Gina Raimondo, en décembre 2024 : « Tenter de freiner la Chine est une entreprise illusoire. »
Parallèlement, les contrôles américains à l’exportation ont stimulé les efforts de la Chine pour développer des alternatives locales, accélérant ainsi l’essor de champions nationaux comme Huawei. Loin de renforcer l’influence américaine sur la Chine, la politique américaine l’érode progressivement. Pour Nvidia, perdre l’accès au marché chinois ne signifie pas seulement perdre des milliards de dollars de revenus. Cela signifie aussi perdre son influence sur l’écosystème d’IA le plus important pour les développeurs hors des États-Unis.
Les récents changements de politique suggèrent que cette prise de conscience commence à se faire sentir. La décision de l’administration Trump d’assouplir les restrictions sur les ventes de puces H2O de Nvidia à la Chine marque un abandon des interdictions générales au profit d’un engagement plus calibré.
Contre toute attente, un tel engagement pourrait constituer une forme plus judicieuse de réduction des risques. Plus la Chine dépendra de la technologie américaine, plus les chaînes d’approvisionnement des deux parties s’entremêleront, et plus il lui sera difficile d’utiliser ses propres actifs stratégiques, notamment les terres rares, comme arme.
 Angela Huyue Zhang, professeure de droit à l’Université de Californie du Sud, est l’auteur de High Wire : How China Regulates Big Tech and Governs Its Economy (Oxford University Press, 2024) et Chinese Antitrust Exceptionalism : How the Rise of China Challenges Global Regulation (Oxford University Press, 2021).
Angela Huyue Zhang, professeure de droit à l’Université de Californie du Sud, est l’auteur de High Wire : How China Regulates Big Tech and Governs Its Economy (Oxford University Press, 2024) et Chinese Antitrust Exceptionalism : How the Rise of China Challenges Global Regulation (Oxford University Press, 2021).
Droits d’auteur : Projet Syndicate, 2025.
www.project-syndicate.org