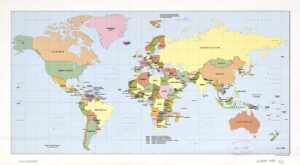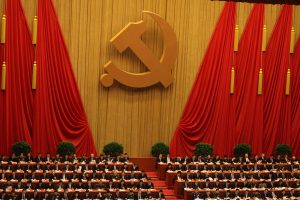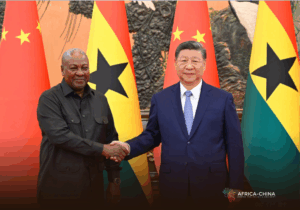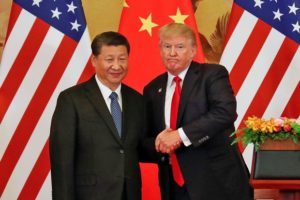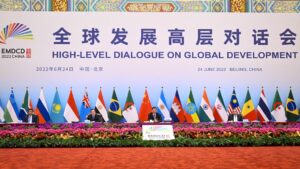Une synthèse sino-américaine est-elle possible ?
De Project Syndicate, par J. Bradford DeLong – Nous devrions tous saluer la publication du nouveau livre de l’analyste sino-canadien Dan Wang, Breakneck: China’s Quest to Engineer the Future.
Oui, je suis partial, car Dan Wang est mon ami. Mais je dirais la même chose si je ne le connaissais pas. Et je ne suis pas le seul . L’économiste Tyler Cowen qualifie Breakneck de « sans conteste le meilleur livre de l’année ». John Thornhill du Financial Times le qualifie de « captivant, provocateur et très personnel ». Patrick Collison, PDG de Stripe, affirme que Dan Wang « éclaire la Chine comme personne d’autre ». Tracy Alloway, de Bloomberg, le qualifie de « l’un des meilleurs auteurs chinois du moment ».
À sept ans, la famille de DanbWang a émigré du Yunnan, à l’extrême sud-ouest de la Chine – où le dialecte local diffère du mandarin parlé à Pékin autant que le cajun louisianais diffère de l’anglais parlé dans le Maine oriental. Il vit désormais à tour de rôle entre Palo Alto et Ann Arbor, et a vécu à Toronto, Ottawa, Philadelphie, Rochester, Fribourg, San Francisco, Kunming, Hong Kong, Pékin, Shanghai et New Haven.
Interlocuteur privilégié du Canada, de la Chine et des États-Unis, Dan Wang trouve ces deux pays « excitants, exaspérants et étranges ». En parcourant l’un ou l’autre, vous découvrirez des endroits qui semblent étranges. Il ne s’agit pas d’un reproche. Contrairement au Canada, où il se sent à l’aise, la Chine et l’Amérique présentent toutes deux les caractéristiques d’un moteur de changement mondial.
Breakneck décrit la Chine comme le pays du marteau-pilon et l’Amérique comme le pays du marteau. L’élite technocratique de l’ingénierie chinoise résout les problèmes avec du béton, de l’acier et des moyens colossaux – avec des routes, des ponts, des centrales électriques et d’autres projets d’envergure. Le même élan s’étend à la société, comme en témoignent la tristement célèbre politique de l’enfant unique et la répression au Tibet et au Xinjiang. La technocratie chinoise valorise l’ordre, le contrôle et les réalisations visibles.
À l’inverse, l’élite légaliste américaine résout les problèmes en attribuant des droits de propriété et de sécurité. Cela crée les conditions permettant aux individus de vivre comme ils l’entendent, et l’esprit d’entreprise et l’innovation s’ensuivent naturellement. La réponse réflexive à tout problème consiste à établir un autre droit, attirant ainsi davantage de personnes dans les cadres nécessaires à l’accord et à l’approbation.
Au fond, pourtant, Américains et Chinois se ressemblent – un fait qui saute aux yeux lorsqu’on compare les Chinois aux Japonais et aux Coréens, ou les Américains aux Canadiens et aux Européens. Les deux peuples sont infatigables et innovants. Tous deux mêlent matérialisme grossier et admiration pour les entrepreneurs. Tous deux tolèrent le manque de goût. Tous deux aiment la compétition. Tous deux sont pragmatiques et n’hésitent pas à précipiter les choses pour « arriver à leurs fins ». Les deux pays regorgent d’escrocs et de charlatans qui vendent des solutions rapides pour accéder à la santé et à la richesse. Tous deux admirent le sublime technologique – de grands projets qui repoussent les limites. Les élites et les masses des deux pays partagent un credo de grandeur nationale, incarné par la « Cité sur la colline » de John Winthrop et Ronald Reagan aux États-Unis, et en Chine par les inscriptions « Pays central » sur les coupes à vin rituelles en bronze de la dynastie Zhou.
Ces deux pays sont également un enchevêtrement d’imperfections, ce qui en fait souvent leurs pires ennemis. Les vieilles étiquettes comme « socialiste », « démocrate » ou « néolibéral » ne conviennent tout simplement plus. La Chine réalise des progrès matériels rapides et visibles, mais au détriment des droits humains et avec des risques d’abus. Sa technocratie léniniste dévie de la voie avec l’ingénierie sociale, passant du pragmatique au grotesque.
L’Amérique dévie de sa voie en passant trop de temps à préciser et à défendre des droits, devenant une vetocratie ultra-litigieuse. Les garde-fous limitent les excès, mais engendrent aussi stagnation et ambitions gaspillées.
La Chine gagnerait à davantage de respect des droits et des règles impersonnelles. Pourtant, l’élite chinoise voit peu d’attrait dans un système qui pourrait élever un Donald Trump au rang de Xi Jinping. De même, les États-Unis ont autrefois construit avec ambition, notamment entre la fin du XIXe siècle et l’après-Seconde Guerre mondiale, mais ils doivent aujourd’hui retrouver cet esprit de construction et d’ingénierie.
La sclérose américaine se manifeste même aux frontières de l’économie mondiale. La Silicon Valley affirme valoriser l’invention, mais elle se construit des bastions grâce aux effets de réseau et aux manœuvres juridiques. La Chine, au contraire, privilégie l’échelle et la production, adhérant à l’éthique du célèbre ancien PDG d’Intel, Andy Grove. Si la Silicon Valley ou le delta de la rivière des Perles parvenaient à équilibrer l’échelle et l’ambition de l’ingénierie avec des droits et des garanties juridiques solides, rien ne pourrait l’arrêter.
Ce qui rend Breakneck si particulier, c’est la façon dont il mêle théorie, données économiques, sociologie et observation personnelle. De nos jours, trop de discours sur la Chine mêlent reportages de troisième main, lointains et dérivés, à des abstractions de think tanks. Mais Wang vit l’histoire. Familier de la cuisine, des rues, des villes et de la politique en Chine, aux États-Unis et au Canada, il apporte le point de vue d’un initié et d’un étranger de passage, permettant aux lecteurs de voir, de ressentir et de goûter les lieux qui font bouger le monde contemporain. Des détails qui semblent être de la couleur deviennent la substance de la compréhension.
L’une des tâches les plus urgentes et les plus ardues du monde au XXIe siècle est peut-être de synthétiser le meilleur de la Chine et de l’Amérique, tout en évitant le pire de chacune. Lisez Breakneck autant pour ses reportages que pour son argumentation – et pour sa réflexion sur les compromis entre ambition et retenue, construction et blocage, coups de massue et coups de marteau.
 J. Bradford DeLong, ancien secrétaire adjoint au Trésor américain, est professeur d’économie à l’Université de Californie à Berkeley et auteur de Slouching Towards Utopia: An Economic History of the Twentieth Century (Basic Books, 2022).
J. Bradford DeLong, ancien secrétaire adjoint au Trésor américain, est professeur d’économie à l’Université de Californie à Berkeley et auteur de Slouching Towards Utopia: An Economic History of the Twentieth Century (Basic Books, 2022).
Droits d’auteur : Projet Syndicate, 2025.
www.project-syndicate.org