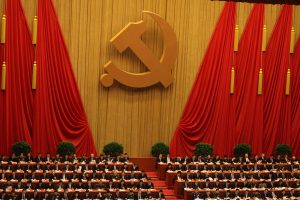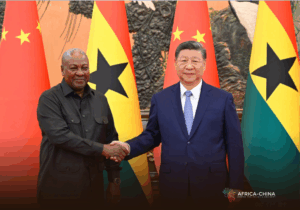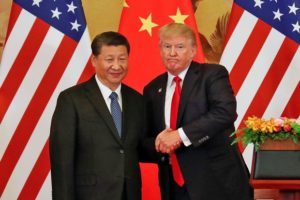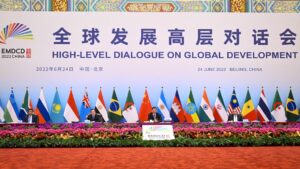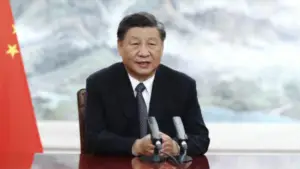La crise de la famille chinoise
De Project Syndicate, par Nancy Qian – L’actualité chinoise se concentre aujourd’hui principalement sur les développements géopolitiques, notamment la rivalité sino-américaine. Mais les 1,4 milliard de Chinois, bien que conscients de ces enjeux, sont davantage préoccupés par un problème qui les touche de près : la diminution de la taille de leurs familles.
Depuis des millénaires, les valeurs confucéennes définissent la famille comme essentielle à l’ordre et à l’harmonie sociaux, les relations familiales jouant un rôle central face à des défis tels que la concurrence pour la terre et les ressources. Les fils géraient les fermes et les entreprises, et prenaient soin de leurs parents âgés. Les filles agrandissaient la famille par le mariage, créant ainsi de vastes réseaux étendus qui assuraient des fonctions économiques et sociales essentielles, comme la construction d’écoles et la résolution des conflits – fonctions qui, en Europe, auraient pu être assurées par l’Église.
Cette structure économique et sociale de base a survécu même aux bouleversements des années 1950-1970, lorsque le nouveau régime communiste a encouragé les gens à vivre dans des dortoirs (loin de leurs familles, y compris de leurs conjoints) et à envoyer leurs enfants dans des crèches et des internats publics afin d’accroître la productivité du travail.
Aujourd’hui, cependant, la famille chinoise est en crise, en raison de la chute du taux de fécondité, qui est passé de 7,51 enfants par femme en 1963 (son pic actuel) à seulement un par femme en 2023. Cet effondrement démographique met en danger l’économie, la société et le système politique de la Chine.
Les problèmes de fertilité en Chine sont profondément ancrés. La population chinoise a plus que doublé entre 1900 et 1979, passant de 400 millions à 969 millions . Les pénuries alimentaires étaient si fréquentes durant cette période que la Chine est devenue surnommée le « pays de la famine ». Entre 1959 et 1961, la Chine a connu la pire famine de son histoire, entraînant la mort de 20 à 45 millions de personnes, conséquence à la fois d’une forte densité de population et de politiques gouvernementales profondément défaillantes. Ainsi, à partir des années 1970, le gouvernement chinois a instauré des lois strictes de planification familiale qui, pendant des décennies, ont limité la plupart des foyers chinois à un seul enfant.
Mais les lois sur la planification familiale ne sont qu’un aspect du problème. Bien que la désormais tristement célèbre politique chinoise de l’enfant unique ait été assouplie à deux enfants en 2016, puis à trois en 2021, les taux de fécondité n’ont pas augmenté.
Et contrairement à d’autres pays aux prises avec de faibles taux de fécondité, comme le Japon et la Corée du Sud, la Chine reste un pays pauvre. Selon les données les plus récentes (de 2022), le revenu disponible médian par habitant en Chine est de 6 224 $ (17 $ par jour) pour les 944 millions de personnes vivant en zone urbaine, et de seulement 2 777 $ (7,6 $ par jour) pour les 465 millions vivant en zone rurale. Aux États-Unis, ce chiffre est de 63 589 $. Même en tenant compte des prix plus élevés aux États-Unis, la différence est énorme. Ajoutez à cela des opportunités économiques limitées pour les jeunes – y compris ceux diplômés de l’université – et les ménages chinois ne peuvent tout simplement pas se permettre d’avoir plus d’enfants.
La nouvelle génération de parents chinois est confrontée à un obstacle psychologique supplémentaire, lié à son manque d’expérience directe des familles nombreuses. La grande majorité d’entre eux ont grandi enfants uniques dans des foyers comptant deux enfants uniques comme parents et quatre grands-parents. Ils n’avaient ni cousins ni frères et sœurs avec qui jouer, mais de nombreux adultes s’occupaient d’eux. Par conséquent, beaucoup n’accordent pas d’importance aux familles nombreuses et trouvent cette notion accablante.
Mais tous ces aidants impliquent de lourdes dépendances à mesure que les générations vieillissent. Une petite cohorte de plus en plus réduite de Chinois en âge de travailler, évoluant sur un marché du travail caractérisé par des opportunités rares et des salaires bas, soutient désormais une population de retraités de plus en plus nombreuse et croissante, qui a un accès limité aux retraites et aux soins de santé. Et leurs responsabilités vont au-delà des finances pour inclure le soutien physique et émotionnel.
Comme si cela ne suffisait pas, chaque jeune est aussi la seule source de fierté pour ses parents et grands-parents, qui ont collectivement consacré leur vie – leur temps, leur énergie et leur argent – à lui assurer la réussite. Les jeunes adultes doivent désormais mériter tous les sacrifices consentis par leurs aidants, compensant ainsi efficacement leurs parents et grands-parents pour les enfants et petits-enfants qui ne sont jamais nés.
Ce poids des responsabilités se fait sentir dès l’enfance. Les aires de jeux sont largement vides et les parcs sont principalement fréquentés par des retraités, même après l’école et le week-end. Les enfants sont plus susceptibles de rester à la maison à étudier qu’à jouer dehors. Toute cette pression pourrait bien alimenter la hausse des taux de dépression et de suicide chez les adolescents et les jeunes adultes.
La situation est vouée à s’aggraver. Le ralentissement de la croissance économique, qui a déjà propulsé le chômage des jeunes à des niveaux historiques , continuera de peser sur le marché du travail, intensifiant la concurrence déjà féroce pour des opportunités limitées, et entravera la capacité du gouvernement à augmenter les retraites.
Le gouvernement chinois a tout intérêt à résoudre la crise des familles du pays. Les problèmes économiques et sociaux ont tendance à évoluer de manière imprévisible et peuvent facilement dégénérer en instabilité politique. Malgré la mise en œuvre d’un large éventail de politiques visant à encourager les familles à avoir des enfants, notamment des incitations financières, la fécondité reste faible.
Comment une civilisation fondée sur les unités et les réseaux familiaux se comportera-t-elle en tant que nation d’individus sans frères, sœurs et cousins ? À quoi ressemblera la vie des personnes âgées lorsque les jeunes adultes seront rares pour s’occuper d’elles ? Le Chinois ordinaire, pour qui la famille représente à la fois une vertu et un mode de vie, peut-il se sentir heureux sans enfants ? Alors que le spectre des bouleversements sociaux et économiques se profile, ces questions doivent trouver des réponses.

Nancy Qian, professeur d’économie à l’Université Northwestern, est codirectrice du Global Poverty Research Lab de l’Université Northwestern, directrice fondatrice du China Econ Lab et professeur invité à l’Institut Einaudi d’économie et de finance.
Droits d’auteur : Project Syndicate, 2025.
www.project-syndicate.org