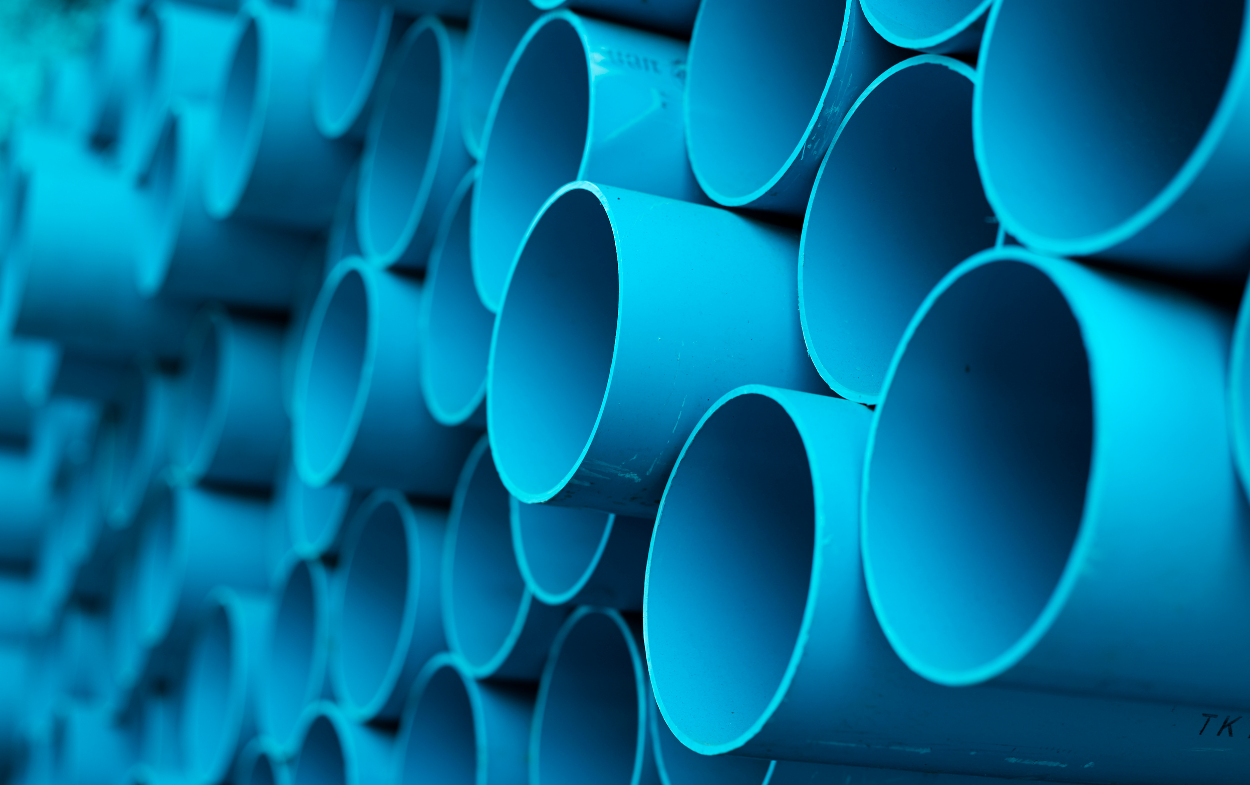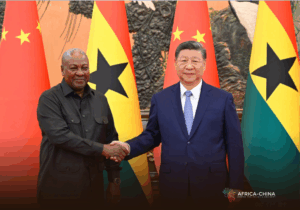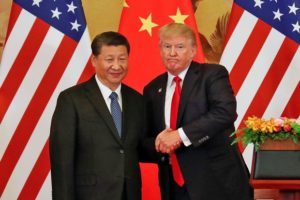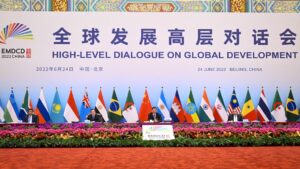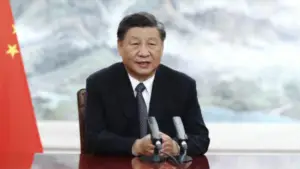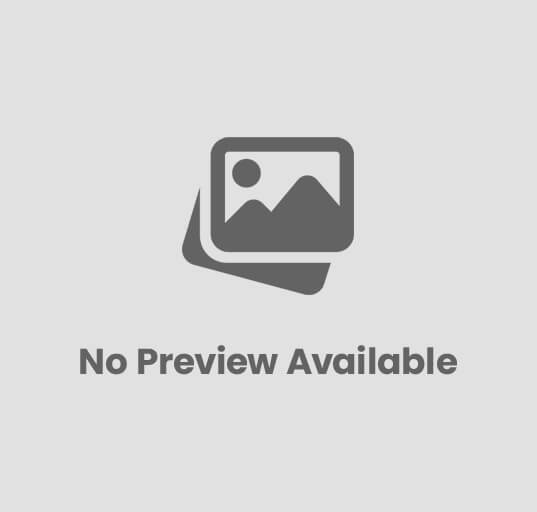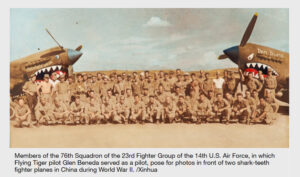La crise du logement en Chine est pire qu’il n’y paraît
Par Project Syndicate, de Yi Fuxian – L’économie chinoise actuelle présente une ressemblance troublante avec celle du Japon des années 1990, lorsque l’éclatement d’une bulle immobilière avait entraîné une stagnation prolongée. Mais les «décennies perdues» du Japon ne sont pas le résultat inévitable de tendances irréversibles ; elles reflètent des erreurs politiques, ancrées dans une compréhension erronée des défis auxquels l’économie était confrontée. Les décideurs chinois commettront-ils les mêmes erreurs ?
La bulle immobilière japonaise a été précédée par une forte hausse du ratio prix de l’immobilier/revenu annuel, celui de Tokyo passant de 8 en 1985 à 18 en 1990. Cette tendance a été alimentée par plusieurs facteurs, notamment la politique fiscale foncière japonaise, la déréglementation financière et la mauvaise coordination des politiques budgétaire et monétaire. Mais la demande des primo-accédants – âgés en moyenne de 39 à 43 ans – a également joué un rôle substantiel.

Se sentant plus riches, les propriétaires consommaient davantage. Cela a fait grimper les prix des biens, des services et des actions, créant ainsi davantage d’emplois et réduisant le chômage. Mais la demande de logements neufs a rapidement commencé à baisser, et les changements démographiques ont joué un rôle clé. En 1991, la part de la population japonaise âgée de 65 ans et plus a augmenté. Lorsque le taux de chômage a atteint 13%, le nombre d’accédants à la propriété a commencé à décliner. La valeur des biens immobiliers a chuté, la bourse s’est effondrée et le Japon est tombé dans un piège déflationniste, caractérisé par une baisse de la fécondité et une hausse du chômage.

Un diagnostic erroné a aggravé la situation : ce qui était en réalité une maladie démographique chronique a été traité comme une maladie aiguë. Les décideurs politiques pensaient que le Japon était aux prises avec une appréciation du yen suite à l’accord du Plaza de 1985, par lequel les principales économies mondiales avaient convenu de dévaluer le dollar. Pour endiguer la hausse de la monnaie, ils ont donc imprimé de la monnaie, abaissé les taux d’intérêt, creusé le déficit public et procédé à un assouplissement quantitatif.
Ces politiques, conjuguées à la reprise du nombre d’acquéreurs de logements amorcée en 2001, ont entraîné une nouvelle hausse des prix de l’immobilier et aggravé le problème sous-jacent. Comme fonder une famille devenait plus coûteux, les jeunes ont retardé leur mariage et ont eu moins d’enfants. Le gouvernement a tenté de stimuler la natalité par des mesures telles que l’augmentation des allocations familiales et l’amélioration des services de garde d’enfants, mais le succès a été limité : le taux de fécondité est passé de 1,26 naissance par femme en 2005 à seulement 1,45 dix ans plus tard.
À ce moment-là, le Premier ministre de l’époque Abe Shinzō s’était fixé comme objectif de porter le taux de fécondité à 1,8. Mais les mesures prises – visant par exemple à faciliter le retour au travail des femmes après un accouchement – n’ont pas pu compenser les effets des politiques monétaires accommodantes , jugées essentielles pour lutter contre la déflation et stimuler la croissance économique. Les prix de l’immobilier ont continué de grimper, le nombre de mariages a encore diminué et les naissances ont chuté . L’année dernière, le taux de fécondité au Japon s’élevait à seulement 1,15 naissance par femme.
Par le passé, le Japon appréciait la faiblesse des taux d’intérêt et du yen, car son économie était fortement dépendante des exportations. Mais le vieillissement et la diminution de sa population active ont généré une pression à la hausse sur les salaires, alimentant ainsi la croissance intérieure. L’inflation, l’affaiblissement du secteur manufacturier et la transformation du Japon, autrefois pays excédentaire, en pays déficitaire, le rendant ainsi vulnérable à l’inflation importée. Ainsi, le Japon a échappé au piège déflationniste pour se retrouver pris dans un piège inflationniste à long terme qui, en réduisant le pouvoir d’achat et la capacité parentale, réduira encore davantage la fécondité. En favorisant un effondrement démographique, la stratégie du Japon pour mettre fin à ses «décennies perdues» a ouvert la voie à des «siècles perdus».
Ceci devrait servir d’avertissement à la Chine, confrontée à ses propres crises immobilières et démographiques. Ces dernières décennies, l’urbanisation rapide, induite par les politiques La rareté artificielle des terrains, la dépendance des collectivités locales à la vente de terrains pour générer des revenus et les attentes exubérantes en matière de croissance future ont entraîné une flambée des prix de l’immobilier. La forte demande des primo-accédants a également contribué à cette hausse : les jeunes Chinois n’ayant généralement pas de frères et sœurs, en raison de décennies de restrictions sur la fécondité, ils ont tendance à acheter leur premier logement environ 11 ans plus tôt que leurs homologues japonais.
Mais le nombre de citadins chinois âgés de 28 à 32 ans a atteint un pic en 2019, et la bulle immobilière a éclaté peu après. Aujourd’hui, le secteur immobilier, qui, à son apogée en 2020-21, contribuait à 25% du PIB total et à 38% des recettes publiques, est pénalisé par une faible demande, un ralentissement de la construction et une forte surcapacité. La baisse des prix a décimé le patrimoine des ménages, avec des pertes équivalentes à la production économique annuelle de la Chine. Cela a mis à mal la consommation, l’emploi, l’emprunt et l’investissement.
La crise qui se prépare en Chine est plus grave que celle qu’a connue le Japon. Tout d’abord, la bulle immobilière chinoise est bien plus importante. Par exemple, l’investissement résidentiel, en pourcentage du PIB, était environ 1,5 fois plus élevé en Chine en 2020 qu’au Japon en 1990. L’immobilier représentait environ 70% du patrimoine total des ménages chinois en 2020, contre environ 50% au Japon en 1990. Le ratio prix/revenu en Chine est aujourd’hui plus de deux fois supérieur à celui du Japon en 1990.
De plus, le taux de fécondité en Chine est plus faible. Alors que le Japon a connu une deuxième vague d’accession à la propriété dix ans après la première, la Chine ne peut s’attendre à rien de tel. La part de la population âgée de plus de 65 ans augmente beaucoup plus vite en Chine qu’au Japon : il a fallu 28 ans au Japon pour atteindre le niveau que la Chine atteindra d’ ici 2040. Durant cette période (1997-2025), la croissance moyenne du PIB japonais n’a été que de 0,6% par an.
Enfin, la Chine est confrontée à des pressions déflationnistes et à un chômage bien plus importants que le Japon . La consommation des ménages chinois ne représentait que 38% du PIB en 2020, contre 50% au Japon en 1990.
Mais le signe le plus inquiétant est peut-être que le gouvernement chinois continue de vanter un taux de croissance potentiel de 5% , certains chiffres importants suggérant qu’il pourrait atteindre 8%. Pour y parvenir, les décideurs politiques mettent en œuvre des mesures à fort rendement à court terme – comme l’augmentation de l’offre de logements abordables et l’ assouplissement quantitatif – tout en ignorant la faiblesse des fondamentaux de l’économie. Comme l’a si bien dit Hegel : « La seule chose que nous apprenons de l’histoire, c’est que nous n’en apprenons rien. »
 Yi Fuxian, scientifique senior à l’Université du Wisconsin-Madison, a été le fer de lance du mouvement contre la politique de l’enfant unique en Chine et est l’auteur de Big Country with an Empty Nest (China Development Press, 2013), qui est passé d’une interdiction en Chine à la première place du classement des 100 meilleurs livres de 2013 en Chine établi par China Publishing Today .
Yi Fuxian, scientifique senior à l’Université du Wisconsin-Madison, a été le fer de lance du mouvement contre la politique de l’enfant unique en Chine et est l’auteur de Big Country with an Empty Nest (China Development Press, 2013), qui est passé d’une interdiction en Chine à la première place du classement des 100 meilleurs livres de 2013 en Chine établi par China Publishing Today .
Droits d’auteur : Project Syndicate, 2025.
www.project-syndicate.org