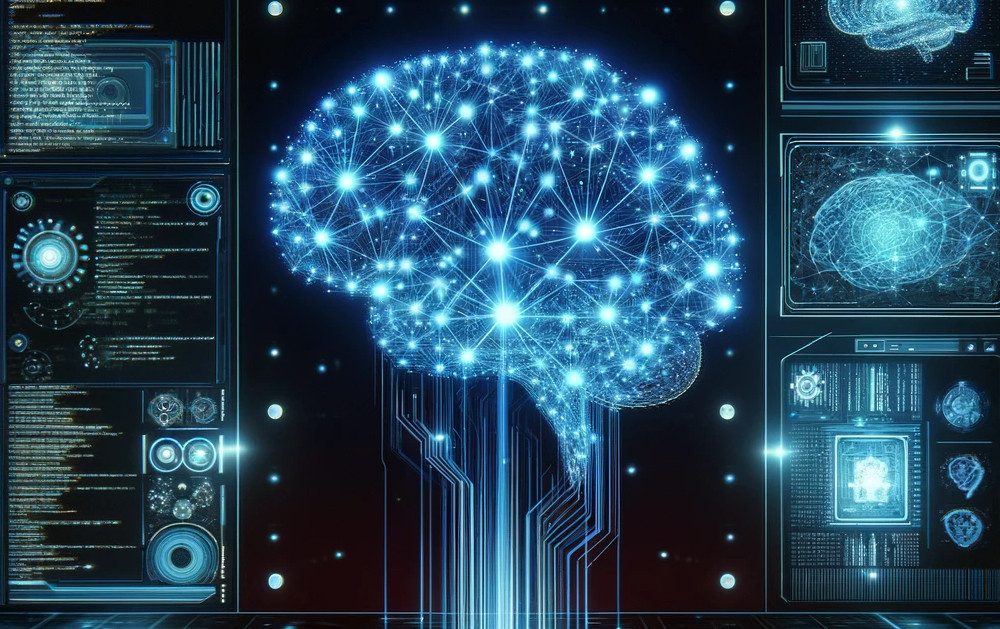
De Project Syndicate, par Stephen S. Roach – Bien que personne n’ait encore officiellement brandi le drapeau à damier dans la course sino-américaine à la suprématie de l’IA, les marchés parient sur la victoire des États-Unis. Le fabricant de puces Nvidia est récemment devenu le numéro un mondial première entreprise à 4 000 milliards de dollars (et son PDG, Jensen Huang, a acquis le statut de rock star mondiale). Microsoft, le plus gros investisseur dans l’entité à but lucratif d’OpenAI, n’est pas loin derrière, avec une valorisation de 3 700 milliards de dollars.
Mais un leadership précoce ne garantit pas la victoire, surtout en matière d’innovation. Il ne se passe pas un jour sans qu’un nouveau rapport ne fasse état des progrès extraordinaires de la Chine en matière d’IA. Les États-Unis ont peut-être innové avec ChatGPT d’OpenAI, mais la société chinoise DeepSeek a surpris le monde en début d’année avec le coût et l’efficacité de traitement de son modèle de langage étendu R1. Et ce mois-ci, la startup chinoise Moonshot AI a lancé son impressionnant modèle Kimi K2, qui surpasse ses concurrents occidentaux sur plusieurs critères clés.
De nombreux facteurs influencent la course à l’IA : non seulement les puissantes puces de Nvidia, mais aussi les talents, les logiciels et l’orientation stratégique. Pour l’instant, les semi-conducteurs constituent un goulot d’étranglement stratégique évident, à l’avantage des États-Unis. Dans le cadre de sa politique de « petit terrain, haute barrière », l’administration Biden a imposé des restrictions strictes aux exportations de semi-conducteurs avancés. Pourtant, cette politique s’est retournée contre elle, encourageant la Chine à poursuivre activement le développement de ses propres puces d’IA .
En fin de compte, je soupçonne que la course à l’IA sera moins déterminée par le matériel que par les avancées stratégiques dans le domaine logiciel. Malgré le Plan d’action pour l’IA récemment annoncé par le président américain Donald Trump, la Chine est bien positionnée pour le long terme. L’ Indice mondial de l’innovation 2024 (GII), qui évalue les performances d’innovation de 133 pays selon 78 indicateurs distincts, classe la Chine au 11e rang – une progression spectaculaire par rapport à il y a 15 ans, où elle était 43e. Dans le même temps, les États-Unis se maintiennent autour de la troisième place.
Si le cadre de l’Indice mondial de l’innovation offre une vue d’ensemble complète des fluctuations de l’innovation dans le monde, il omet une pièce essentielle : la recherche théorique fondamentale. L’intervention des pouvoirs publics joue ici un rôle crucial. Contrairement aux acteurs privés, motivés par des retombées commerciales, le soutien public donne aux scientifiques et autres chercheurs la latitude nécessaire pour repousser les frontières apparemment abstraites de la connaissance.
Sur ce point, les États-Unis sont dangereusement en deçà de la réalité. Selon les statistiques officielles de la National Science Foundation (NSF), la part du gouvernement fédéral dans les dépenses totales américaines en recherche et développement est en baisse depuis le pic post-Spoutnik de 1964. Pour la recherche fondamentale, en particulier, la part du gouvernement fédéral dans les dépenses totales est passée d’un peu moins de 30% à la fin des années 1970 à environ 10% en 2023.
Plus déconcertantes encore sont les attaques de l’administration Trump contre la recherche scientifique et l’enseignement supérieur (soi-disant pour abolir les programmes de diversité, d’équité et d’inclusion), ainsi que l’état d’esprit anti-collaboratif nourri par la sinophobie de plus en plus inquiétante aux États-Unis. Selon une évaluation détaillée de la R&D récemment publiée par l’Association américaine pour l’avancement de la science, le projet de budget de Trump pour l’exercice 2026 réduira probablement le financement fédéral de la recherche fondamentale à seulement 30 milliards de dollars, soit une baisse de 34% par rapport aux 45 milliards de dollars prévus pour l’exercice 2025. Selon les indicateurs de la NSF , cela marquerait un retour aux niveaux observés pour la dernière fois en 2002.
En revanche, la Chine a investi massivement dans la mise en œuvre de son ambitieux programme scientifique et technologique, représentant 28% des investissements mondiaux en R&D en 2023, soit un peu moins que les États-Unis, qui en représentaient 29%. Avec une croissance annuelle moyenne des dépenses chinoises en R&D de près de 14% au cours des dix dernières années, soit plus de trois fois et demie le rythme de 3,7% des États-Unis, la convergence s’est probablement produite en 2024.
Bien que les chiffres nationaux comparables en matière de recherche fondamentale ne soient pas facilement disponibles, Jimmy Goodrich, expert non résident au Centre d’études stratégiques et internationales, a tenté de les calculer. Son extrapolation de la croissance tendancielle de la R&D chinoise aboutit à la conclusion stupéfiante que l’administration Trump est en train de céder l’avance historique des États-Unis en matière de recherche fondamentale financée par l’État.
Pourquoi ? La même question pourrait être posée à propos de nombreux revirements politiques de Trump 2.0, des droits de douane aux réductions de l’aide étrangère en passant par le recul des initiatives en matière d’énergie propre. La plupart de ces mesures étaient décrites dans le Projet 2025 de la Heritage Foundation, le programme conservateur du second mandat de Trump. Mais l’un des principaux objectifs de ce plan était censé être de « défendre, mobiliser et orienter l’écosystème d’innovation américain ». Le démantèlement de la recherche fondamentale qui s’en est suivi est tout sauf cela. Au contraire, il frise le suicide économique et concurrentiel.
Le président chinois Xi Jinping est d’un avis diamétralement opposé. Poursuivant l’accent mis par son prédécesseur sur le « développement scientifique », Xi Jinping souligne depuis longtemps l’importance de la recherche fondamentale comme pilier de l’innovation chinoise. Début 2023, il a affirmé que « renforcer la recherche fondamentale est une exigence urgente pour parvenir à une plus grande autonomie et à une plus grande puissance scientifique et technologique, et c’est la seule voie pour devenir un leader mondial en science et technologie ».
La bataille mondiale actuelle pour la suprématie de l’IA est souvent présentée comme un conflit entre deux systèmes : le modèle américain axé sur le marché et la politique industrielle chinoise, soutenue par l’État. Mais la recherche fondamentale est le grand égalisateur. Que le système soit porté par le secteur public ou privé, l’innovation naît en fin de compte de la découverte.
Genesis: Artificial Intelligence, Hope, and the Human Spirit , un ouvrage de feu Henry Kissinger, Craig Mundie et Eric Schmidt , affirme que « la découverte est peut-être la capacité la plus exaltante de l’espèce humaine ». Maintenir une culture de la découverte nécessite de soutenir la recherche fondamentale, qui est non seulement abstraite et théorique, mais qui ratisse large. Inventeurs de la poudre à canon et du papier, les Chinois ont depuis longtemps retenu cette leçon. Malheureusement, l’Amérique pourrait bien être sur le point de la réapprendre à ses dépens.

Stephen S. Roach, membre du corps professoral de l’Université Yale et ancien président de Morgan Stanley Asia, est l’auteur de Unbalanced: The Codependency of America and China (Yale University Press, 2014) et Accidental Conflict: America, China, and the Clash of False Narratives (Yale University Press, 2022).
Droits d’auteur : Project Syndicate, 2025.
www.project-syndicate.org