Les ajustements économiques rapides de la Chine
De Project Syndicate, par Zhang Jun – Le modèle économique qui a soutenu la croissance économique chinoise pendant plus de deux décennies s’est effondré ces dernières années, notamment depuis le début de la pandémie de COVID-19. Aujourd’hui, la combinaison de l’incertitude croissante et de la baisse de confiance jette une ombre sombre sur l’économie chinoise.
Les raisons immédiates du déclin du modèle économique dominant de la Chine sont externes. En particulier, les évolutions géopolitiques – principalement l’aggravation des tensions commerciales, notamment avec les États-Unis – ont ébranlé le secteur des exportations chinoises. De plus, la nouvelle administration du président élu américain Donald Trump s’apprête à imposer des droits de douane encore plus élevés sur les produits chinois et à durcir les restrictions d’accès de la Chine aux technologies étrangères.
Ces facteurs externes suffiraient à eux seuls à exiger un profond ajustement intérieur en Chine, notamment une mise à jour du modèle économique en vigueur. Mais les évolutions internes sont encore plus pertinentes. Après des années d’investissements excessifs, les projets d’infrastructures génèrent des rendements décroissants, et le secteur immobilier, autrefois florissant, est miné par des dettes importantes, une chute des prix et un stock massif de logements invendus. La morosité de l’économie numérique n’arrange rien.
Beaucoup de ces développements ont mis du temps à se produire. Dès 2013, l’économie chinoise était confrontée à une forte volatilité et à une montée en flèche des risques financiers. Avec un excès de crédit injecté dans les infrastructures physiques et l’immobilier, le ratio dette/PIB a grimpé en flèche et la surcapacité a affecté plusieurs secteurs, notamment l’extraction du charbon, la sidérurgie et le ciment.
Les principaux dirigeants chinois ont reconnu la nécessité de freiner la croissance des investissements et de trouver de nouvelles sources de productivité, et ont admis que cela pourrait nécessiter une nouvelle période de transformation structurelle importante pour le pays. En 2015, le gouvernement a mis en place un ensemble de politiques visant à accélérer les ajustements de l’offre, à promouvoir la transformation structurelle (notamment par l’adoption des technologies numériques) et à encourager l’investissement dans les industries de pointe, telles que la microélectronique, l’intelligence artificielle, les produits bio-pharmaceutiques, les panneaux solaires, les batteries au lithium et les véhicules électriques (VE). De nombreux secteurs, dont l’immobilier, l’industrie manufacturière et les services, ont depuis subi des ajustements importants, entraînant une période douloureuse de croissance en L.
Mais la transformation nécessaire est loin d’être achevée, et la conjoncture économique évolue rapidement. Alors que les exportateurs chinois sont confrontés à une forte incertitude quant à l’environnement extérieur, les ajustements de politique intérieure ont plongé les secteurs de l’immobilier et de la construction dans le surendettement.
Pour atténuer les risques, les entreprises adoptent de plus en plus les technologies numériques, et des capitaux croissants sont investis dans l’IA. Davantage d’entreprises devraient suivre cette voie. La pénétration du numérique alimente une concurrence dynamique, les startups s’affirmant rapidement pour défier – et même détruire – les acteurs en place qui ne parviennent pas à suivre. Mais si de nouvelles « voies » continuent d’émerger, notamment dans les secteurs de pointe, elles seront bientôt saturées.
Les Chinois utilisent de plus en plus le terme « involution » pour décrire la concurrence inutile et excessive qui gangrène désormais certains secteurs de leur économie. Les jeunes évoquent souvent ce concept lorsqu’ils évoquent l’intense concurrence sur le marché du travail : à l’heure où l’offre de diplômés universitaires performants augmente, la refonte des modèles économiques et la flexibilité des modalités de travail ont compromis la stabilité de la création d’emplois.
Mais l’involution peut également s’appliquer à la surconsommation dans des secteurs dynamiques ou prometteurs, causée par un afflux de ressources financières et de facteurs de production. L’industrie chinoise des véhicules électriques en est un exemple typique. Grâce aux investissements massifs des entreprises établies et des nouveaux acteurs, la production chinoise de véhicules électriques est passée de 1,27 million en 2018 à dix millions cette année. Comme on pouvait s’y attendre, cette augmentation rapide de l’offre a entraîné une baisse des prix.
Cela suggère que les chocs d’offre, plutôt qu’une baisse de la demande, sont la principale cause de la déflation chinoise. De fait, il y a de bonnes raisons de penser que les effets des ajustements structurels en cours sur l’offre sont l’un des principaux moteurs du ralentissement économique chinois. Mais la courbe de croissance future de la Chine ne doit pas nécessairement être en forme de « L ». Le pays dispose de tous les outils – et de la résilience – nécessaires pour s’adapter à son nouvel environnement géopolitique, accélérer sa transformation intérieure, renforcer son dynamisme économique et entrer dans une nouvelle phase de développement.
Cela ne signifie pas que la Chine puisse retrouver les taux de croissance d’il y a vingt ans. Au contraire, elle a dépassé le stade de développement où une croissance soutenue à deux chiffres est envisageable . L’impératif pour les dirigeants chinois dans les années à venir ne sera pas de réaliser la croissance à tout prix, mais plutôt de compenser les coûts sociaux de l’accélération de la transformation structurelle par des efforts visant à réduire l’incertitude et à maintenir la stabilité. Le gouvernement chinois devrait notamment renforcer le filet de sécurité sociale et orienter davantage les dépenses budgétaires vers le soutien des revenus et du bien-être des ménages. En renforçant la confiance et la stabilité, ces efforts contribueraient grandement à améliorer le ratio consommation/PIB de la Chine.
 Zhang Jun, doyen de l’École d’économie de l’Université Fudan, est directeur du Centre chinois d’études économiques, un groupe de réflexion basé à Shanghai.
Zhang Jun, doyen de l’École d’économie de l’Université Fudan, est directeur du Centre chinois d’études économiques, un groupe de réflexion basé à Shanghai.
Droits d’auteur : Project Syndicate, 2024.
www.project-syndicate.org






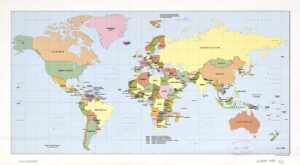




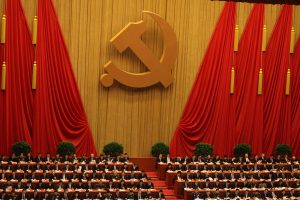




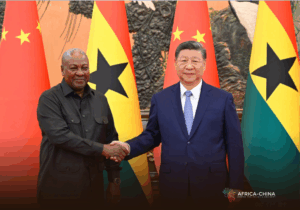
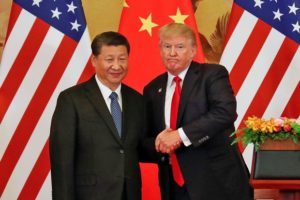










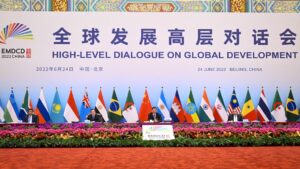


Laisser un commentaire